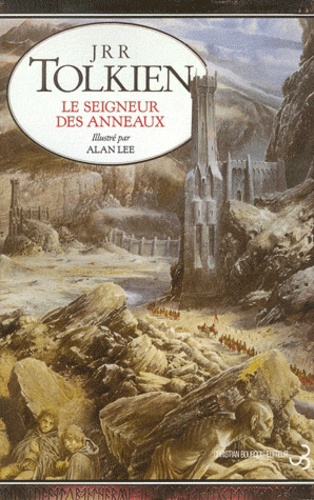
Vingt ans après, me voilà à relire -et pour la première fois !- l'une des œuvres qui ont forgé mon imaginaire, donné envie de découvrir de nouvelles contrées et, à mon tour, modestement, de coucher sur le papier quelques petites histoires. Car si je n'ai rouvert Le Seigneur des Anneaux pendant deux décennies, l'univers fabuleux créé par Tolkien ne m'a quasiment jamais quitté. Depuis 1990, j'ai lu une partie de ses œuvres, toujours en cours de publication en France, prolongé mes visites en Terre du Milieu par des lectures analytiques (parfois en anglais), et si vous êtes un(e) fidèle lecteur/trice de ce blog, vous avez pu mesurer l'ampleur de cette passion. En gros je vous en rabats les oreilles et les mirettes :)
Il y a trois ans j'avais même pu évoluer virtuellement dans cet univers par le biais du jeu video en ligne qui porte le nom du roman. Il en est même résulté plusieurs dizaines de comptes-rendus de quêtes qui n'amusaient presque que moi. Mais je n'osais me remettre à cette lecture, pourtant si évidente. La peur d'être déçu, de ne pas trouver dans cette œuvre -pourtant élue "roman du siècle" par les universitaires anglais (oui bon)- toutes les vertus, toute la richesse qu'on lui prête, tout l'émerveillement que j'avais éprouvé à l'âge de 15 ans... Ce n'est qu'après quelques discussions avec des amis (qui se reconnaîtront) que je me suis finalement décidé. Cet article ne se veut pas une analyse complète, ni même esquissée du bouquin (il faudrait probablement rédiger une véritable encyclopédie pour cela !), mais une suite -ordonnée, je l'espère- de réflexions qui me sont venues au fil de ma lecture, enrichie par d'autres lectures exégétiques. L’occasion pour moi de relire certains de mes articles précédents et le cas échéant, de les corriger. Mais rassurez-vous, je n’ai pas cédé au syndrome Tolkien consistant à réécrire encore et toujours mes textes.

Après une lecture fade, frustrante et inutilement tarabiscotée, j'ai laissé en plan le roman de hard SF que j'avais emprunté à ma bibliothèque et me suis replongé dans La Communauté de l'Anneau, premier volet du triptyque. Pour les néophytes l'entame du roman pourrait constituer une barrière infranchissable. Tolkien y prend le temps de développer la société hobbite, du nom de ces petits êtres paisibles qui marchent pieds nus et vivent dans la Comté.
C'est à la faveur d'une fête d'anniversaire du plus fameux d'entre eux que l'histoire démarre véritablement. Car Bilbon Sacquet défraya en son temps la chronique en allant vivre des aventures échevelées hors de la Comté (ces aventures sont contées de fort belle manière dans le roman Bilbo le Hobbit, dont le ton est plus enfantin que dans Le Seigneur des Anneaux). Ce qui fit de lui un original, un fou et une légende. Lors de ses 111 ans, il disparut subitement, au propre comme au figuré, laissant son smial (un trou dans un tertre faisant office de maison hobbite) à son neveu Frodo. Mais l'héritage le plus précieux de ce dernier est plutôt un anneau en or, portant d'étranges inscriptions en runes elfiques, qui possède entre autres le pouvoir de rendre invisible celui qui le passe à son doigt. Conseillé par Gandalf, un sorcier en qui Bilbo avait toute confiance, Frodo décida de partir à son tour quelques années plus tard afin de détruire l'Anneau, dont le maléfique propriétaire vient de se réveiller au loin. Commence alors pour Frodo, accompagné de son jardinier Sam et de ses amis Merry et Pippin, la plus incroyable des aventures...
Je l'ai dit, cet univers ne m'a pas quitté depuis 20 ans. Mais en 20 ans, on oublie des choses. On oublie la traversée inquiétante de la Comté, avec de sombres cavaliers aux trousses. On oublie que les Hobbits ont failli périr dans les Hauts des Galgals, ce plateau glacial où des tertres funéraires sont hantés par des créatures aussi mystérieuses que fatales. On oublie (bien aidé par les films de Peter Jackson) tout l'épisode concernant Tom Bombadil, personnage mystérieux et champêtre que les commentateurs ont fini par ériger en parangon de la nature, de la paix et de la poésie intemporelles. Un personnage littéralement adoré par les lecteurs du roman. On oublie l'importance du Conseil d'Elrond, qui contient en germe beaucoup d'éléments propres à la terre du Milieu. Bien que située en début de roman, cette séquence tient une place centrale, névralgique. On peut y voir les relations (et donc la méconnaissance) des différentes peuplades et races, l'importance des légendes, la noblesse, innée ou acquise, de certains protagonistes. Mais aussi la possibilité pour des personnages que l'on aurait pu penser mineurs, de s'affirmer.
Dans Le Seigneur des Anneaux on parle très peu des dieux, la prière des personnages se réduit souvent à des chants pour se donner du courage. Pourtant Tolkien était un chrétien très croyant, mais il ne souhaitait pas faire de prosélytisme. Les notions de Bien et de Mal sont très présentes en arrière-plan du roman, et une seule séquence, si l’on en croit les exégètes, nous montre une volonté supérieure qui tire les ficelles lors de l’affrontement entre Gandalf et le Balrog dans la Moria. Gandalf en sortira transfiguré, au sens propre du terme, et le parallèle avec une figure christique est facile.

L’élément central du roman est bien sûr l’Anneau que porte Frodo, un terrible fardeau puisque celui-ci, outre une puissance quasi infinie, est aussi une maladie qui ronge son porteur. Gollum, ancien porteur de l'Anneau, –qui a fait l’objet de nombreuses analyses- a irrémédiablement été transformé physiquement et psychologiquement, et Frodo n’en guérira jamais complètement. On a souvent reproché à Tolkien d’avoir fait de son roman une longue métaphore de la seconde guerre mondiale. Et surtout de faire l’apologie de la guerre, de la violence ; il est vrai que plusieurs batailles sont décrites au fil du roman. Il faut biaiser cette impression, sachant que Tolkien a participé à la première Guerre mondiale (dans les tranchées en France), et qu’il était un humaniste convaincu. Cependant des passages du roman peuvent entraîner la confusion, comme par exemple lorsque Pippin espère à haute voix la fin de la guerre et que l’instant d’après il admire la prestance guerrière d’un allié qu’il vient de croiser. La naïveté, ou plutôt l’ingénuité du Hobbit permet d’affranchir Tolkien de toute ambivalence à mon avis, les réflexions de celui-ci étant dictées par ses humeurs, un peu comme un jeune enfant.
Le Mal semble aussi avoir une origine géographique ; ainsi dans le roman, l’Est semble presque systématiquement être synonyme de malveillance, puisque c’est vers l’est de la Terre du Milieu que Sauron tient sa forteresse. Ce qui nous permet de glisser vers le thème du racisme, dont a été taxé pendant longtemps l’auteur, notamment en raison de la personnification ou la manière de s’exprimer de ses créatures maléfiques. Le rapprochement avec les Allemands (soyons clairs) est totalement idiot puisque l’auteur s’est déclaré très tôt opposé au nazisme, mais qu’il était de tout cœur avec le peuple teuton. Et puis soyons sérieux, la Communauté de l’Anneau comprend des êtres assez dissemblables dans leurs langues, leurs coutumes, leur aspect physique également.
Le temps crée aussi des raccourcis. Comme les chamailleries incessantes du nain et de l’Elfe. Ou le rôle de Boromir réduit à celui de simple spectateur. Dans l’absolu aucun des membres de la Communauté n’est laissé de côté, traité comme un figurant. Mais dans le prologue, Tolkien parle largement des Hobbits, peut-être parce que ceux-ci sont une création de son fait, alors que Nains et Elfes existaient déjà dans les mythologies. A noter que les Hobbits ont un côté un peu « enfantin » ; ils sont capables de deviser de choses futiles au bord du gouffre…
Mais le temps a figé des expressions immortelles : « l’arc de Legolas chantait. » « Vous ne pouvez passer. » « Monsieur Frodon ! »...
A la relecture, on remarque des défauts de traduction, des éléments qui se contredisent. Mais aussi des unités de mesures typiquement britanniques qui auraient mérité soit une note, soit d’être réellement converties en système métrique. Vous savez, vous, à quoi correspond un furlong, un yard, un mile ? A la décharge de Francis Ledoux, le traducteur français, la somme de travail devait être gigantesque et il n’avait pas forcément le temps de tout réviser. Une révision de cette traduction est en cours, initiée par Vincent Ferré, chargé des œuvres de Tolkien chez son éditeur, Christian Bourgois.

Un élément dont je n’avais pas pris conscience lors de ma première lecture, c’est l’omniprésence, ou du moins la forte présence, des chants. Chacun des membres de la Communauté, à un moment ou à un autre, entonne un chant. Pour se rassurer, pour exprimer ses sentiments, comme la peur, la joie, la peine, pour évoquer des figures légendaires ou des temps lointains, pour se donner du courage, etc. La Terre du Milieu doit son existence à un chant ou une musique, celui ou celle des Ainur, avec l’aide d’Ilúvatar. Lorsque nos amis séjournent à la Lorien, ils entendent les chants des Elfes. Pendant la bataille, les Orques aussi chantent à leur façon. Même l’arc de Legolas chante !
Rapidement la Communauté se fragmente (avant de se retrouver) en duos. Frodo/Sam (j’y reviendrai d’ailleurs), Aragorn/Gandalf, Pippin/Merry, Gimli/Legolas. Seul Boromir est à part, encore que parfois on puisse le mettre aux côtés d’Aragorn, Gandalf étant un personnage très particulier. Après la séparation des membres, certains forment un duo avec un personnage secondaire. On a alors des duos tels que Pippin/Denethor, Merry/Theoden, Merry/Eowyn, Eomer/Aragorn, etc. Cette propension à la dualité ou à l’amitié virile à son revers : la forte présomption d’homosexualité de certains des personnages. Un passage ou deux concernant Frodo et Sam ne laisse d’ailleurs pas de doute, Sam se disant par exemple « je l’aime ». A plusieurs reprises, le jardinier se presse contre son maître, l’embrasse. Les mots ne vont pas plus loin, mais l’impression est forte. La remarque vaudrait aussi pour les « couples » Aragorn/Eomer et Legolas/Gimli, mais à des degrés moindres. Les théoriciens sur ce sujet arguent aussi de l’absence flagrante de personnages féminins dans le récit : aucune femme dans la Communauté, et la présence féminine se réduit à Arwen, Eowyn et Galadriel. Tolkien n’était pourtant pas misogyne, il aimait infiniment sa femme, qu’il a d’ailleurs un peu transposée dans Arwen, l’Elfe qu’aime Aragorn.
/http%3A%2F%2Fimados.fr%2Fhistory%2F25%2Fle-seigneur-des-anneaux-tome-3-le-retour-du.jpg)
Sur l’ensemble du roman, on notera que le second volume, Les Deux Tours, est moins jouissif que le premier. Il y a beaucoup de batailles, moins de découverte du monde merveilleux (enfin, tout est relatif) créé par Tolkien et de ses créatures, même si sur le plan narratif il avance beaucoup. Pas mal de questions se font jour. C’est d’ailleurs là le principal défaut inhérent au SdA : tellement de choses sont suggérées, effleurées, que c’en est presque frustrant ; et seule une partie sera contée ou dévoilée dans le roman ou dans les autres volumes de l’Histoire de la Terre du Milieu…
Le Retour du Roi, volet conclusif, nous montre l’achèvement des différents fils narratifs, le destin de nombreux personnages, principaux ou secondaires, et s’étire en une longue conclusion. Il fallait bien ça pour la foule des héros heureux ou malheureux. Il lui manque cependant une touche finale, un épilogue se déroulant quinze ans plus tard, mais que Tolkien n’a pas jugé bon d’inclure dans la version originale, ni même dans les éditions ultérieures. La qualité d’écriture de ce chapitre est un cran en-dessous du reste, mais pour la cohérence de l’ensemble, il eût peut-être été intéressant de l’intégrer. A priori ce n’est pas prévu dans la révision de la traduction en cours chez Christian Bourgois, l’éditeur.
Le Seigneur des Anneaux est un voyage dans le temps, qui nous propose un decorum moyenageux, mais avec des personnages fantasmés, tels les Orques, le Balrog ou encore… les Hobbits. C’est donc de la fantasy ; on considère d’ailleurs que Tolkien, qui n’a pas « initié » le genre, en a pour longtemps figé les codes. C’est aussi un voyage dans l’espace, au travers bien sûr des déplacements de membres de la Communauté, dans une partie de la Terre du Milieu. Certains lieux sont seulement évoqués, mais permettent au lecteur de rêver, de fantasmer sur ce qu’ils pourraient être. La lecture du Seigneur des Anneaux sans de fréquents retours à la carte qui y est accolée n’aurait d’ailleurs pas la même saveur. Un voyage dans les mots, puisque la langue elfique en particulier y fait quelques incursions.
/http%3A%2F%2Fimworld.aufeminin.com%2Fdossiers%2FD20091110%2Fseigneur-150150_L.jpg)
Mais si l’on ne s’attache pas trop à ces incohérences –mineures pour la plupart-, il n’en reste pas moins que le Seigneur des Anneaux est un formidable roman d’aventure, une épopée magnifique avec des personnages inoubliables. Ce n’est que la partie immergée de l’iceberg, une sorte de « porte-étendard » d’une œuvre touffue, un véritable univers complet dont je vous ai déjà largement parlé, et vous parlerai encore.
Spooky.

/http%3A%2F%2Fwww.deviantart.com%2Fdownload%2F136098259%2FBeren_and_Luthien_by_Iardacil.jpg)
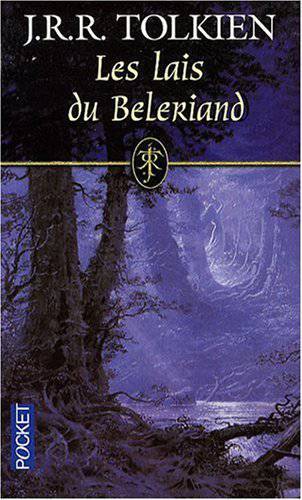




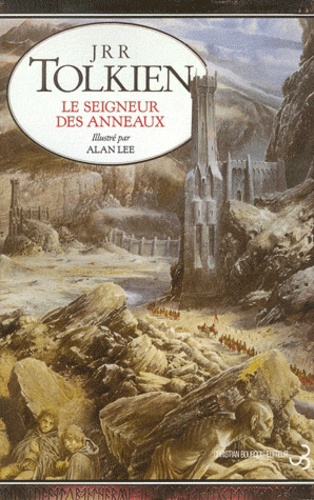



/http%3A%2F%2Fimados.fr%2Fhistory%2F25%2Fle-seigneur-des-anneaux-tome-3-le-retour-du.jpg)
/http%3A%2F%2Fimworld.aufeminin.com%2Fdossiers%2FD20091110%2Fseigneur-150150_L.jpg)
/http%3A%2F%2Fa69.g.akamai.net%2Fn%2F69%2F10688%2Fv1%2Fimg5.allocine.fr%2Facmedia%2Fmedias%2Fnmedia%2F18%2F35%2F19%2F86%2F18404391.jpg)
/http%3A%2F%2Fa69.g.akamai.net%2Fn%2F69%2F10688%2Fv1%2Fimg5.allocine.fr%2Facmedia%2Fcinestore%2Fvisuel%2F02%2F39%2F023929.jpg)
/http%3A%2F%2Fwww.atelier-empreinte.fr%2Fimages%2Fbilboalbum1.jpg)







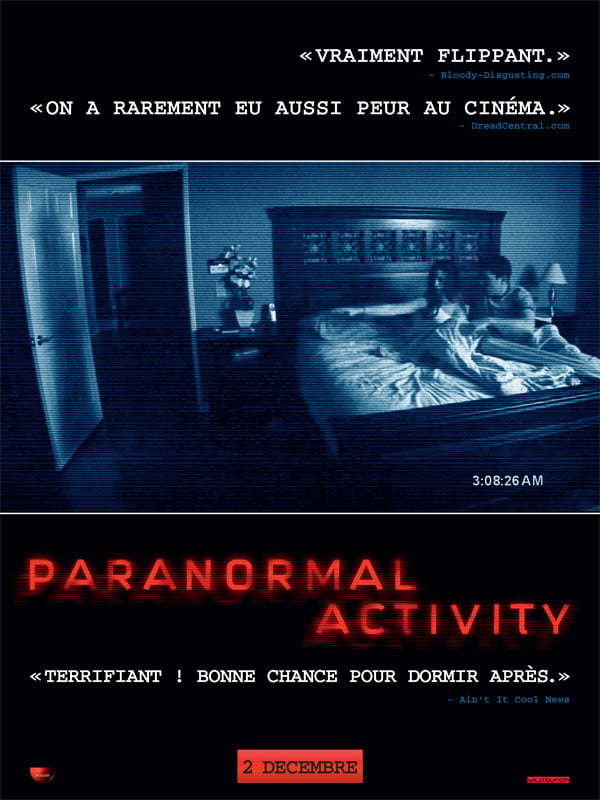

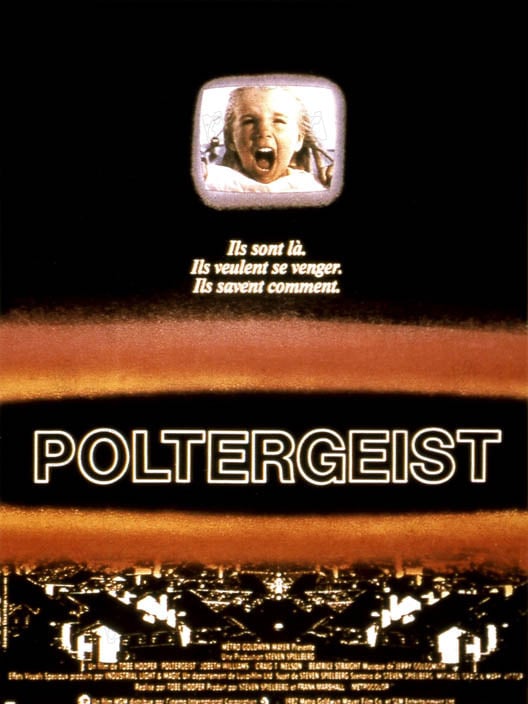

/image%2F1014460%2F20240410%2Fob_0568de_9782226481474-j.jpg%3Fitok%3DOcvnKcTJ)
/image%2F1014460%2F20240402%2Fob_d074e3_9782253937012-001-t.jpeg%3Fitok%3DGFvSaCRV)
/image%2F1014460%2F20240328%2Fob_3398d5_8adca156c274816e9d0b9c2570577a033fe638.jpg)
/image%2F1014460%2F20240304%2Fob_475fa9_5168199.jpg)
/image%2F1014460%2F20240223%2Fob_3b2950_m02841726371-large.jpg)
/image%2F1014460%2F20240216%2Fob_094bcc_3764699.jpg)